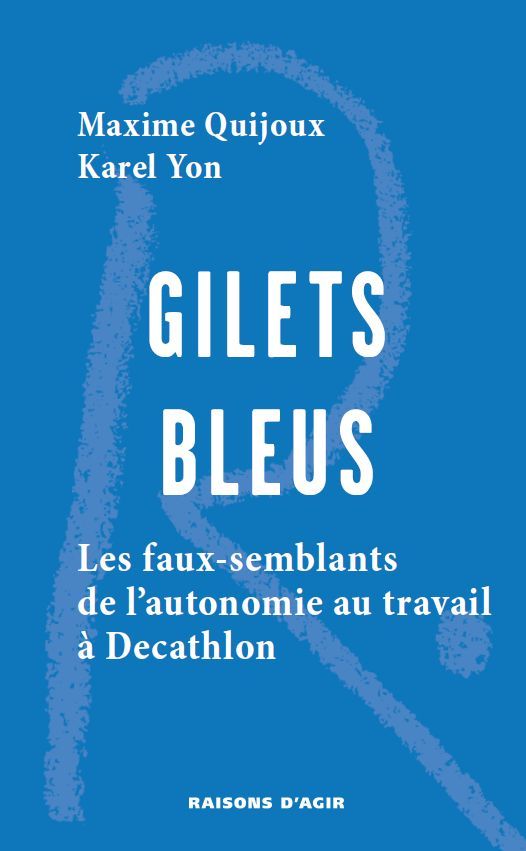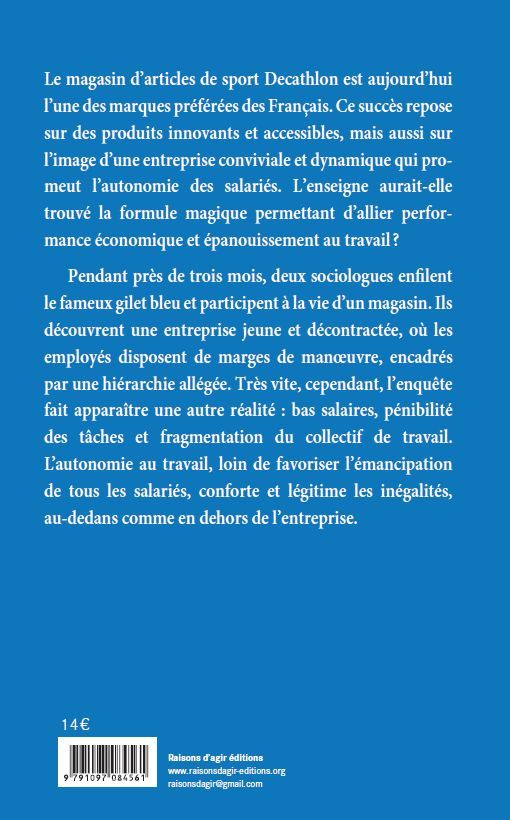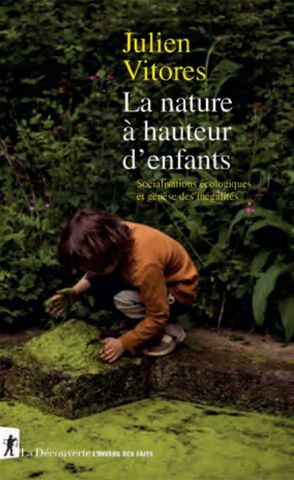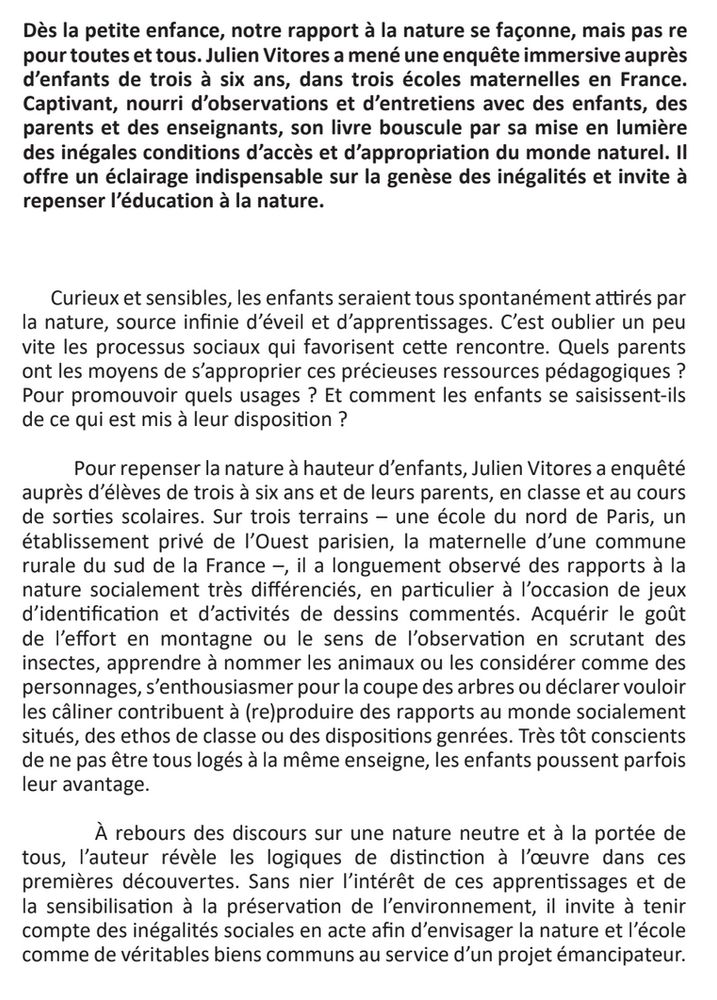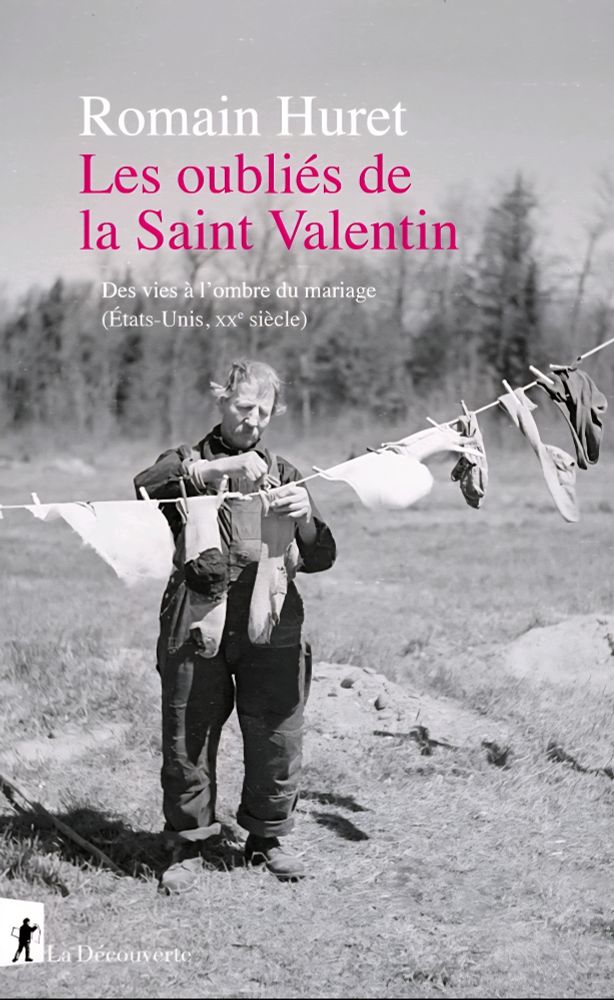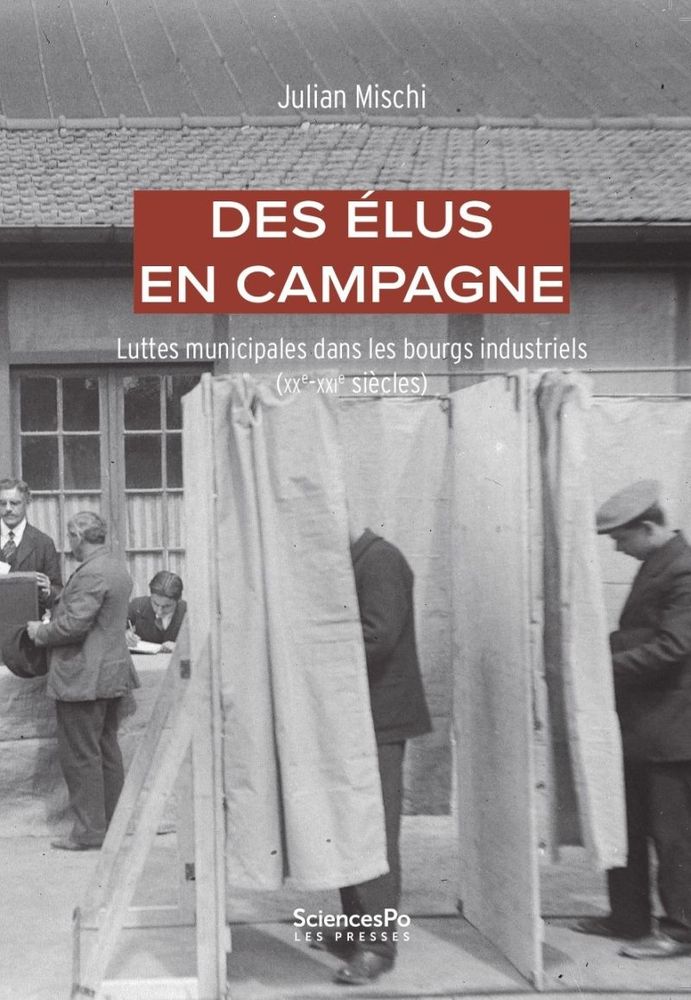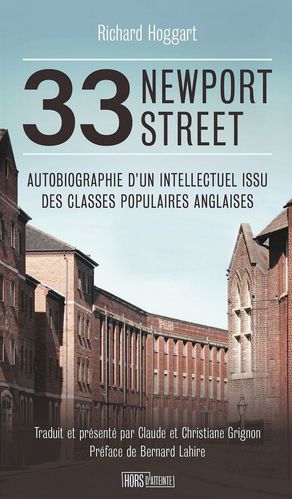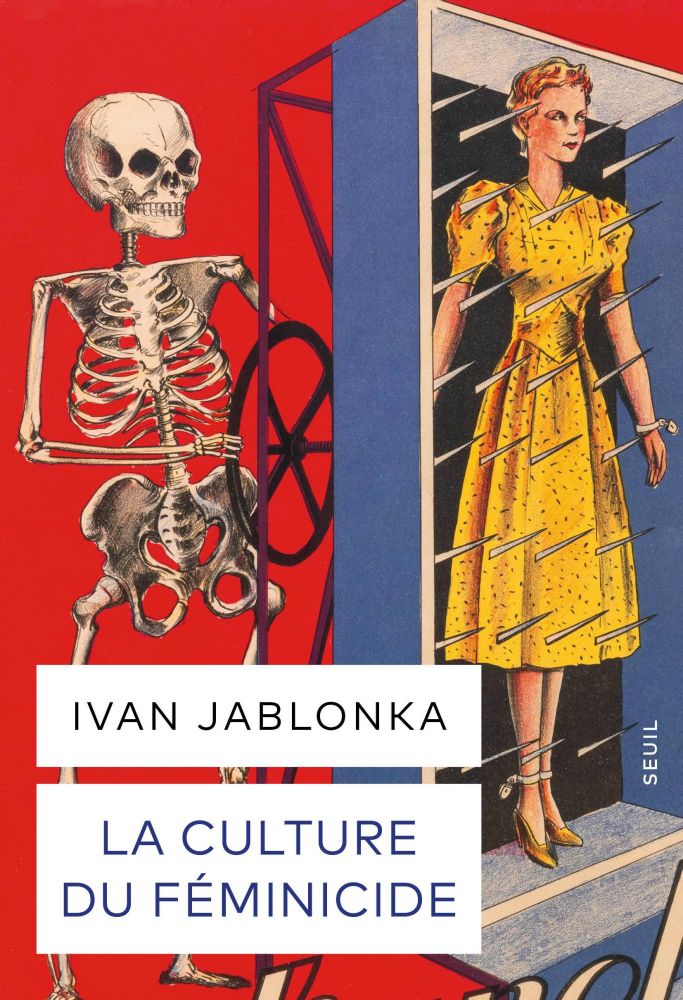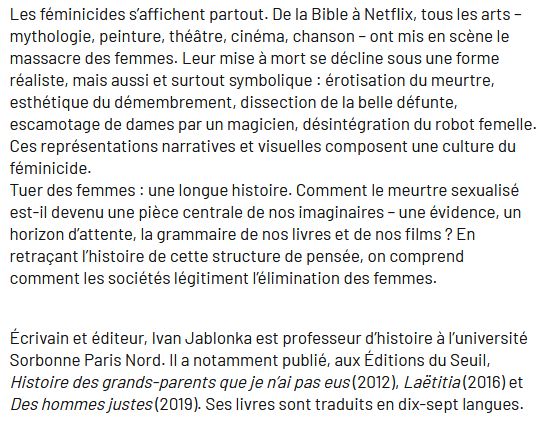Mehdi Arfaoui
@mehdiarfaoui.bsky.social
2.3K followers
1.4K following
350 posts
🧪 Sociologue au Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL (linc.cnil.fr)
📚 Chercheur associé au CEMS-EHESS
☕ Veille bibliographique en SHS => #VeilleSHS
🎥 Auteur de http://fictionsocio.fr / @fictionsocio.bsky.social
Site perso : mehdi.arfaoui.net
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Reposted by Mehdi Arfaoui
Reposted by Mehdi Arfaoui
Reposted by Mehdi Arfaoui
Reposted by Mehdi Arfaoui
Reposted by Mehdi Arfaoui
Mehdi Arfaoui
@mehdiarfaoui.bsky.social
· Aug 19
Reposted by Mehdi Arfaoui