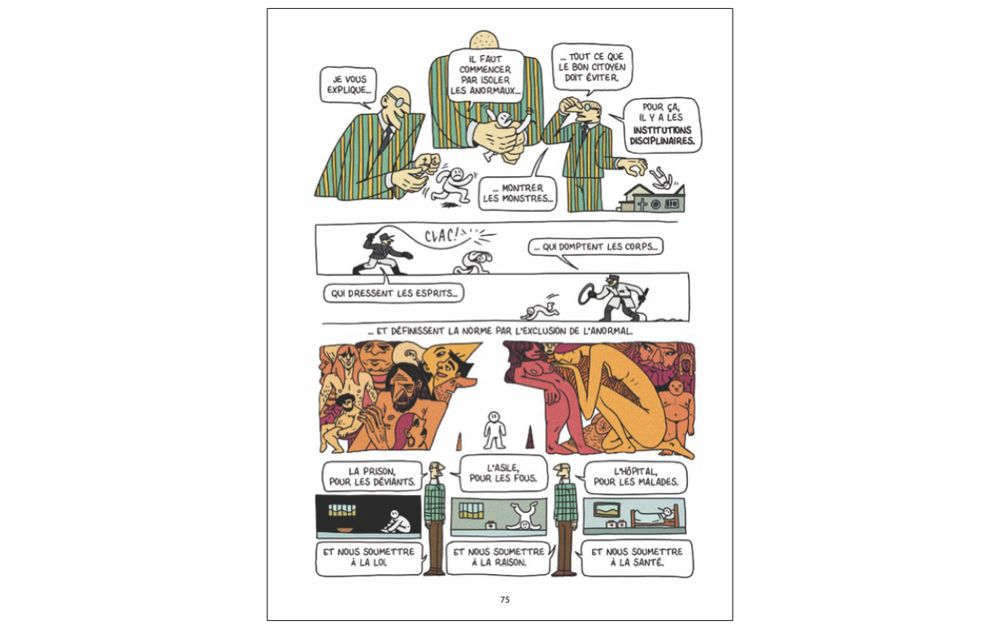“Pour Averroès, la religion n’est que la traduction inférieure de ce que la philosophie dit parfaitement”
“Pour Averroès, la religion n’est que la traduction inférieure de ce que la philosophie dit parfaitement”
hschlegel
dim 05/10/2025 - 18:00
En savoir plus sur “Pour Averroès, la religion n’est que la traduction inférieure de ce que la philosophie dit parfaitement”
Averroès, philosophe arabo-musulman originaire d’Al-Andalus, est né il y a 900 ans. À cette occasion, l’Institut du monde arabe, à Paris, lui consacre un cycle spécial dans le cadre de ses conférences « Falsafa, les rendez-vous de la philosophie arabe ». Jean-Baptiste Brenet, professeur de philosophie arabe à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous présente ce penseur.
[CTA2]
« Averroès : pour quoi faire ? » La conférence de Jean-Baptiste Brenet aura lieu en accès libre à l’Institut du monde arabe (IMA), à Paris, le mardi 7 octobre. Retrouvez toutes les infos sur le site de l’IMA. En partenariat avec Philosophie magazine.
Comment la transmission de l’œuvre d’Aristote s’est-elle effectuée auprès d’Averroès ?
Jean-Baptiste Brenet : Averroès (1126-1998) a découvert les textes d’Aristote par le biais des traductions réalisées dans l’Islam oriental à partir du Xe siècle, l’époque de la grandeur de Bagdad (Irak), celle du « cercle d’al-Kindi » [lire à ce sujet notre grand entretien avec Emma Gannagé]. Les corpus scientifique et philosophique grecs sont alors traduits en arabe, parfois directement, parfois à partir du syriaque. Au gré de l’expansion de l’islam et de la circulation du corpus scientifique, Aristote parvient en Andalousie (al-Andalus), sous domination musulmane [lire notre article]. Averroès est l’héritier de cette translatio studiorum. Il reçoit la quasi-totalité du corpus d’Aristote (à l’exception des Politiques). Le néo-platonisme (Plotin, Proclus) est également présent, influent, mais il tâchera de s’en écarter pour épurer son « aristotélisme ». Averroès ne lit que l’arabe, pas le grec. Les traductions d’Aristote qu’il a sous les yeux sont de qualité inégale, il y est sensible, et cela stimule son effort d’exégète.
Averroès est surnommé “le commentateur”. En quoi consiste son travail ?
Du point de vue professionnel, Averroès est d’abord un juge et un juriste. Il exerce aussi comme médecin – il sera le médecin personnel du calife, à la suite d’Ibn Tufayl [lire notre article]. Mais il est surtout philosophe, et s’il rédige quelques traités personnels, c’est à commenter Aristote qu’il aura en effet consacré sa vie. On distingue trois formes de commentaires. Les « Compendia », d’abord, ou « Épitomés », qui sont des synthèses des livres d’Aristote. Il s’agit d’œuvres de jeunesse, influencées entre autres par ses lectures d’Alexandre d’Aphrodise ou d’Ibn Bâjja (Avempace). Les « Commentaires moyens », ensuite, qui sont des paraphrases du Stagirite. Averroès résume le texte, le reformule, le plus souvent sans s’en écarter. On y voit à l’œuvre, toutefois, une synthèse intelligente, précise, qu’on peut qualifier de « néo-aristotélicienne ». Enfin, les « Grands commentaires », qui constituent des explications linéaires dans lesquelles Averroès découpe et cite le texte original, qu’il analyse presque mot à mot. C’est là que se manifestent sa subtilité et son génie d’interprète. Ce sont, justement, ces œuvres qui auront le plus d’influence dans le monde occidental latin : non seulement formellement (Averroès aura d’une certaine manière appris à l’Occident à lire le texte d’Aristote), mais conceptuellement, nombre de ses analyses devenant un bien commun de la scolastique.
“Pour Averroès, les philosophes n’ont pas besoin de la Révélation pour accéder à des vérités supérieures, car la philosophie explique intégralement l’Univers” Jean-Baptiste Brenet
Averroès est un philosophe musulman. En quoi sa foi influence-t-elle sa pensée ?
Quand Averroès commente Aristote, en philosophe et pour des philosophes, il n’y a pas le Coran. La philosophie est autonome et indépendante, elle est pour lui l’expression parfaite de la vérité. On connaît la formule célèbre de la scolastique latine : « La philosophie est la servante de la théologie. » Cette idée, Averroès y est totalement étranger. Pour lui, la religion n’est jamais que la traduction inférieure de ce que la philosophie dit parfaitement, c’est-à-dire sous forme démonstrative et conceptuellement pure. Autrement dit, il n’a rien d’un exégète coranique, même s’il est convaincu de la véracité de sa religion. À l’entendre, la philosophie et la religion s’adressent à des types de personnes différents (même si aucun homme ne peut faire l’économie de l’enfance et de la société, et donc grandit dans une religion). Le Coran s’adresse à l’ensemble de l’humanité, de manière assez simple et imagée, tandis que la philosophie s’adresse à un nombre plus restreint de gens, qui ne raisonnent que par concepts et démonstration. Ces derniers n’ont pas besoin de la Révélation pour accéder à des vérités supérieures ; l’Univers, pour eux, est sans opacité, il s’explique intégralement. Cela étant, les vérités aristotéliciennes et religieuses ne s’opposent pas ; ce sont deux versants d’une même réalité. L’humanité a faim de vérité. La religion est là pour donner à l’ensemble des êtres humains le vrai sous une forme digeste, compréhensible, efficace, ce que la philosophie, dans sa complexité, ne saurait offrir.
Il existe pourtant des différences de taille entre les écrits d’Aristote et du Coran. Comment concilier les deux ?
Les cas de figure sont simples. Soit la philosophie parle de ce dont ne parle pas le Coran, et il n’y a pas de conflit, mais coexistence, voire complémentarité. Soit les deux s’accordent explicitement, et c’est sans difficulté. Soit les paroles divergent. Dans ce cas, Averroès considère que la contradiction n’est jamais que superficielle, littérale. Le conflit de sens est évident, mais se règle. Pourquoi ? Parce que philosophie et Révélation sont deux expressions d’une seule et même vérité. La vérité ne se contredisant pas elle-même, il faut simplement trouver le moyen, en faisant jouer les significations, d’accorder les deux discours. Cela s’appelle l’interprétation. C’est l’opération qui dégage le sens « caché » du sens obvie. Le théologien al-Ghazali [lire notre article] – qu’Averroès récuse par ailleurs – soutenait déjà que tout musulman devait admettre qu’une lecture intégralement littérale du Coran et de la tradition ne tenait pas. Les paroles du Prophète sont toujours signifiantes, mais peuvent s’entendre à différents niveaux. Averroès y souscrit, à sa façon. En cas d’opposition avec les conclusions philosophiques, il faut interpréter le texte religieux. Seul le philosophe le peut et le doit, lui qui repère exactement le point de divergence et maîtrise le point d’arrivée. Par sa connaissance de la langue arabe, de la Révélation et de la tradition, il s’agir pour lui de faire jouer les significations pour faire en sorte que les formules du Coran rejoignent les démonstrations d’Aristote.
“Selon lui, philosophie et Révélation sont deux expressions d’une seule et même vérité. Donc s’il y divergence entre les deux, les contradictions ne sont jamais que superficielles” Jean-Baptiste Brenet
Un exemple concret de cette approche ?
Pensons à la question de la vie future. C’est l’un des dogmes qui vaut aux philosophes d’être taxés d’hérésie par al-Ghazali. En islam, non seulement l’âme est immortelle, mais elle retrouve son corps : c’est l’individu, corps et âme, qui jouit éternellement du paradis ou souffre éternellement de l’enfer. Le problème est double pour Averroès : d’une part, parce que comme ses prédécesseurs (Ibn Sina, c’est à dire Avicenne, en premier lieu), il récuse philosophiquement l’idée d’une résurrection des corps ; d’autre part, parce qu’en tant qu’aristotélicien, il soutient que l’âme individuelle se corrompt en même temps que le corps dont elle est la forme. Ce qui reste à la mort de l’individu, ce n’est que l’intellect, c’est-à-dire la puissance « spécifique » de penser, que cet individu aura mise en œuvre singulièrement au cours de sa vie mais qui, à sa disparition, trouvera à s’employer par le biais d’autres corps. Ce qui reste de nous, autrement dit, n’est pas « à » nous proprement ; c’est l’intelligence humaine, sans mémoire individuelle, sans affects, une pure capacité de penser.
Averroès semble au plus loin, ici, de la parole coranique.
Tout son effort – mais il reste vague, car il rechigne à l’exercice – consiste à affirmer que la philosophie ne nie aucunement la vie future (ce qui serait bien hérétique), mais discute de sa modalité (ce qui ne l’est pas, et, de fait, n’a rien d’évident), et à suggérer que quand le Coran parle de la mort, comparée au sommeil, il faut en vérité comprendre avec Aristote que l’intellect commun perd seulement l’un de ses instruments, c’est-à-dire un corps individuel parmi d’autres ; et que sans être lui-même détruit, il se trouve associé à d’autres corps humains doués d’imagination qui, par le biais des images, viendront l’activer. C’est cela, la vie future : l’activité incessante de l’intellect de l’espèce, appuyé sur des corps quelconques, toujours disponibles. Il n’y a aucune immortalité personnelle. On comprend qu’Averroès n’ait pas souhaité l’exposer dans des textes non philosophiques.
“La vérité ne se contredisant pas elle-même, Averroès considère qu’en cas de divergences entre philosophie et Coran, il faut simplement trouver le moyen d’accorder les deux discours… par l’interprétation !” Jean-Baptiste Brenet
Averroès semble déployer une pensée assez intellectualiste, voire élitiste.
Elle l’est incontestablement, et c’est un lot commun de la pensée arabe. Tout repose sur l’idée d’un partage anthropologique : s’ils relèvent tous d’une même espèce, tous les humains ne se valent pas ; il y a les gens de l’élite, il y a les gens de la foule, de la masse, qui se divise elle-même en plusieurs catégories. C’est une affaire de providence et de physico-chimie. Car c’est le « mélange » caractérisant les corps qui distingue les individus. Averroès pense que tous les hommes n’ont pas la même complexion, ce que l’on appellera plus tard l’ingenium. Nos corps dépendent d’un certain dosage, d’un équilibre entre les qualités élémentaires (le chaud, le sec, le froid, l’humide) qui conditionne ce qu’ils peuvent. Tout cela joue sur notre chair, sur notre mémoire, sur notre capacité de raisonner. L’usage que nous faisons de cette puissance immatérielle qu’est l’intellect dépend en effet d’un ancrage très corporel. Cela veut dire, en tout cas, qu’au sein de l’humanité, il existe des classes étanches, des groupes humains de constitution similaire, qui seront portés vers certaines activités et seront plus ou moins sensibles à certains types de discours. Cela étant, tous les humains le sont en tant qu’ils ont l’intellect pour essence, pour forme. C’est la rationalité qui fait le lien. Et la juste variété des régimes de discours doit permettre à chacun, en dépit des coupures, d’accéder au vrai dans la mesure qui lui convient.
Il y a les gens nés pour être philosophes, et les autres ?
Oui. Sur la base d’une « nature » commune, il existe divers types de « naturels ». Mais pour Averroès, le destin de chacun dépend aussi de facteurs accidentels ou moraux (le lieu de naissance, le climat, l’éducation, la guerre, les maladies, etc.). Je peux être disposé à la philosophie sans jamais actualiser pleinement cette puissance, et la gâcher : par paresse, par distraction, faute de bons livres, de bons professeurs, de bonne fortune… Autrement dit, il ne suffit pas de naître philosophe, il faut le devenir ! Ce que je mange, l’air que je respire, la chance que j’aurai, mon courage, tout cela participe de ma construction. Le déterminisme n’est jamais total, par conséquent : Averroès défend un principe d’indétermination et d’engagement moral où se joue la liberté humaine.
Du vivant d’Averroès, la dynastie au pouvoir en Andalousie change : les Almoravides sont renversés par les Almohades. Il existe notamment une controverse entre eux au sujet du dieu anthropomorphe. Comment Averroès se positionne-t-il dans cette affaire ?
Les Almohades reprochent aux Almoravides, qui se voulaient eux-mêmes fermes, d’avoir dévoyé le dogme. Ils entendent notamment réaffirmer le principe d’immatérialité de Dieu. Certains passages du Coran ou de la tradition, lus littéralement, peuvent laisser penser que Dieu est une sorte de super-homme, qu’Il serait doté d’un corps et d’attributs physiques. Par exemple, le hadîth de Muhammad disant : « La pierre noire est la main droite de Dieu sur terre. » Dieu aurait donc une main ? Al-Ghazali martèle qu’on ne saurait le dire, que ce serait aller contre Son absolue transcendance, et qu’une telle parole ne vaut qu’analogiquement. La position d’Averroès aura évolué sur cette question. Non pas philosophiquement, puisque le « dieu » d’Aristote n’est rien qu’un Intellect, moteur de l’Univers, et qu’il n’a rien de corporel, mais – sous la pression du pouvoir – s’agissant du discours qu’on peut adresser à la foule. Si celle-ci ne peut rien se figurer qu’en l’imaginant, une certaine anthropomorphisation de Dieu n’est-elle pas acceptable, voire nécessaire, qui permet à l’individu religieux de se représenter en partie le Créateur ? Averroès explique que ce n’est pas l’image comme telle, par conséquent, qui pose problème, mais le type d’image qu’on choisira. En l’occurrence, il faut donner au vulgaire l’image que Dieu donne de Lui-même dans le Coran. Qu’est-ce que Dieu ? Il est « lumière ». Voilà une bonne figuration, dira Averroès ; non seulement parce qu’elle vient de Dieu même, mais parce que la lumière est, dans l’ordre sensible que la foule comprend, la plus subtile des réalités. Et le philosophe lui aussi, d’interprétation en interprétation, saura s’y retrouver…
“Qu’est-ce que Dieu ? Il est ‘lumière’. Voilà une bonne figuration, dira Averroès ; non seulement parce qu’elle vient de Dieu même, mais parce que la lumière est, dans l’ordre sensible que la foule comprend, la plus subtile des réalités” Jean-Baptiste Brenet
Quel est l’intérêt pour le pouvoir d’avoir quelqu’un comme Averroès à ses côtés ?
Sans doute les premiers califes almohades ont-ils sincèrement aimé la philosophie et souhaité défendre la rationalité, qui s’accordait en partie avec l’idéologie de leur guide, Ibn Tûmart [lire notre article]. Ils avaient besoin d’Averroès pour défendre, d’un point de vue juridique et religieux, cette option « rationalisante », pour assurer qu’elle ne contrevenait pas aux dogmes de l’islam. Averroès, de son côté, y trouvait lui aussi un intérêt majeur. Non pas matériel, professionnel, égoïste. Son souci, je crois, est plus profond, il est métaphysique. La nature ne fait rien en vain. Il ne peut pas y avoir d’espèce qui soit vaine, c’est-à-dire de puissance qui ne soit pas destinée à s’actualiser – on retrouve Aristote. Or l’humain est une espèce rationnelle, faite pour penser, et toujours menacée par son désœuvrement, son impuissance. Puisque l’homme ne peut vivre qu’en société, il faut donc impérativement bâtir la cité « vertueuse » qui permettra à la philosophie d’advenir et de se déployer. Quelle est cette cité ? Celle d’un pouvoir fort, au dehors, au-dedans, qui permet à tout le monde, sans la perturbation des théologiens, d’embrasser l’islam, et qui, sans publicité, donne à la philosophie les moyens de s’exercer. C’est cela qu’Averroès aura trouvé auprès de ses protecteurs pendant plusieurs décennies.
J’ai lu qu’Averroès était mort sur la roue, ou bien écrasé par une charrette, ou encore étouffé par un serpent. A-t-on le fin mot de l’histoire ?
Tout cela est faux. Il est mort à Marrakech, sans qu’on sache de quoi, ni comment – sans doute était-il malade. Ce qui est sûr, c’est qu’à la fin de sa vie, Averroès a dû subir un exil d’un an, probablement victime de querelles de palais. Peu avant son décès, le calife l’avait rappelé auprès de lui. Son corps fut d’abord enterré à Marrakech avant d’être transféré à Cordoue, dit-on, où – sans preuve archéologique certaine – il reposerait encore aujourd’hui.
octobre 2025