Percight
@percight.bsky.social
220 followers
130 following
510 posts
Fervent thésauriseur de lumières linguistiques (parfois atterrées).
Compagnon de route du Conservatoire national du jeu vidéo. Relecteur pour @thirdeditions.bsky.social et « Images des mathématiques » — C.N.R.S.
Avatar et image d’en-tête : Naoko Shimoda.
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Pinned
Reposted by Percight
Reposted by Percight
Reposted by Percight

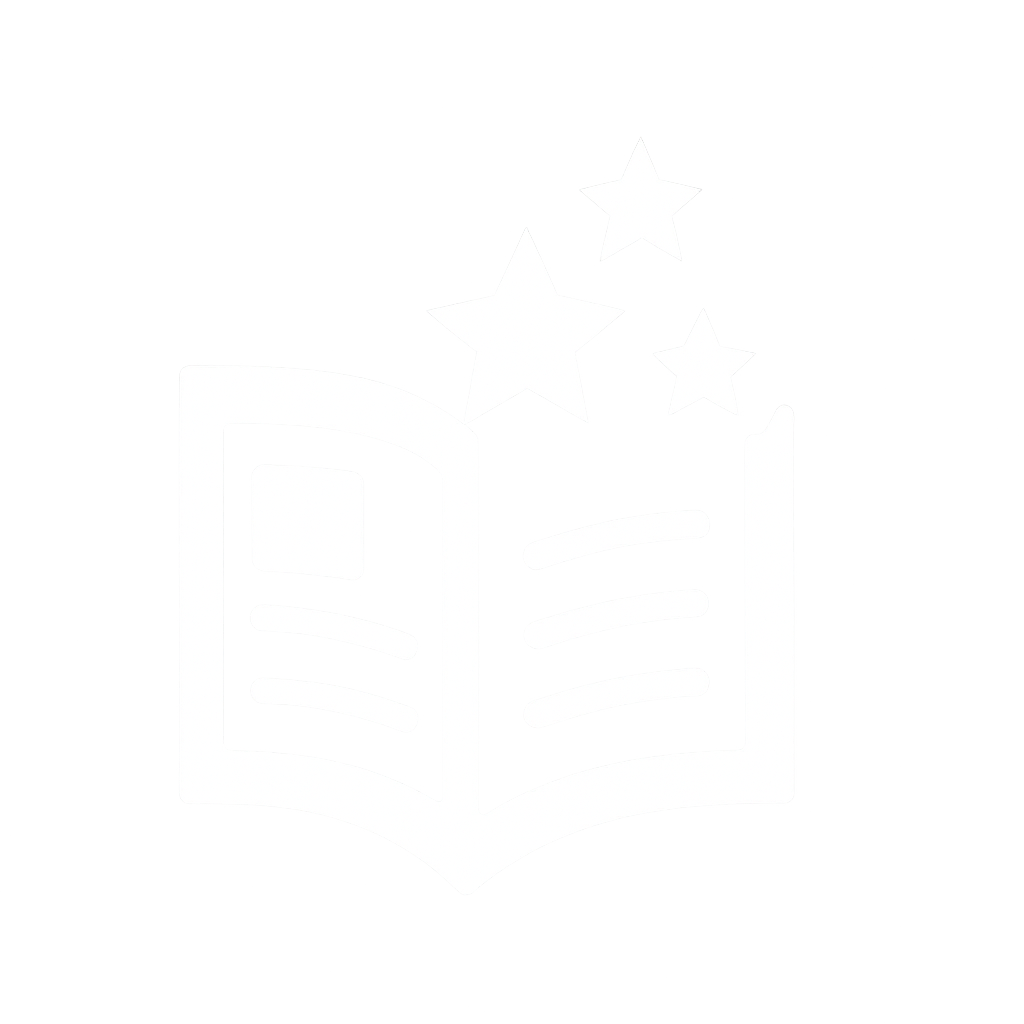







![À la page 10 du document :
« C’est évidemment le mot “théorie I”, c’est-à-dire le terme abstrait et scientifique, qui est le plus fréquent en français et qui fait l’objet de la liste des “dix mots d’un monde à venir”.
Exercice 2
Comment appelle-t-on deux mots qui ont la même forme (orthographe et/ou prononciation) mais des sens différents ?
Des homonymes [mot en gras] (c’est ce que signifie le chiffre romain avant le mot en entrée dans le “Dictionnaire”). Il s’agit d’une présentation spécifique pour les mots qui ont la même forme (graphique et sonore, c’est-à-dire qui sont à la fois “homographes” et “homophones”), mais un sens différent et une étymologie distincte : on remarquera ici que l’étymon grec (= le mot d’origine) est le même (“theôria” < “theôreîn”), mais que sa signification a différé selon les contextes d’emploi. »
J’ai surligné : « homonymes [mot en gras] (c’est ce que signifie le chiffre romain avant le mot en entrée dans le “Dictionnaire”). Il s’agit d’une présentation spécifique pour les mots qui ont la même forme (graphique et sonore, c’est-à-dire qui sont à la fois “homographes” et “homophones”) ».](https://cdn.bsky.app/img/feed_thumbnail/plain/did:plc:m7zsuqtwgrjrbjppktzpjo4o/bafkreie5yjlplf3ttsieovuao66yd3k33eh4pfuo2hduqnox63dukoxvgu@jpeg)




![Première note de la page « Louis IX » dans « Wikipédia » : « Le roi Louis IX peut être désigné par [“]saint Louis[”] ou [“]Saint Louis[”] : la minuscule signale alors la sainteté tandis que la majuscule fait référence au surnom (comme on aurait “Louis le Saint”). »](https://cdn.bsky.app/img/feed_thumbnail/plain/did:plc:m7zsuqtwgrjrbjppktzpjo4o/bafkreidsmutzlvfgbbdrcnnw5okinp7gtxjbingdymscxjyzdh2zkwcjw4@jpeg)
